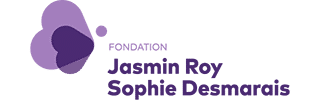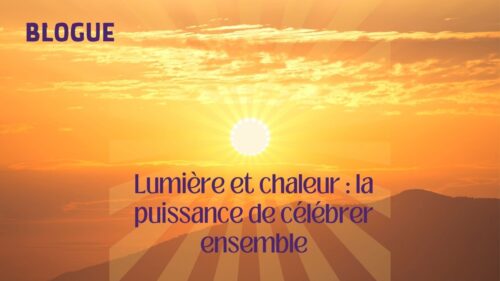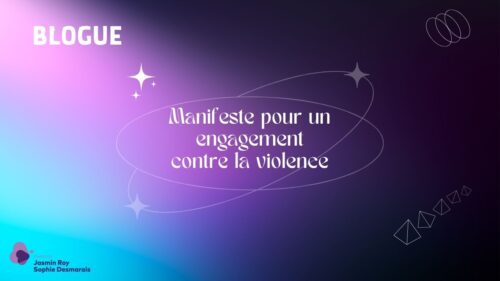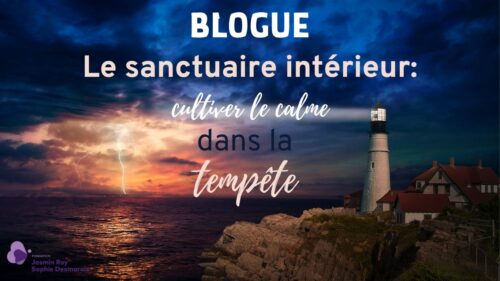Pour souligner la journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie, la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais publie un blogue spécial portant sur les données de son vaste sondage national canadien rendu public en août 2024. Le document utilisé pour ce blogue contient une bibliographie complète et est disponible sur la page de notre sondage, ou suivant ce lien.
La diversité sexuelle et de genre au Canada : un sondage national révélateur
Rédigé par Michel Dorais, PhD, professeur émérite de l’Université Laval, professeur associé à l’École de travail social et de criminologie
Avec la collaboration de Dominic Bourdages et Coralie Desjardins, CROP, Recherche Marketing et Sondages, et de Jasmin Roy, président de la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais
Résumé
Le présent article résume les principales révélations d’un vaste sondage national réalisé au Canada par la firme de sondage CROP et commandité par la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais en 2024. L’auteur a agi à titre de conseiller scientifique, principalement pour la formulation des questions (une cinquantaine) et l’analyse détaillée des réponses. Cette analyse des résultats montre que les personnes issues de la diversité sexuelle et de genre, tout particulièrement les jeunes et les personnes trans ou non binaires, subissent beaucoup plus que les autres divers types de violence, d’intimidation et de discrimination, et éprouvent davantage de problèmes de santé mentale. Ces données mettent particulièrement en lumière les besoins d’aide et de soutien des jeunes issus de la diversité sexuelle et de genre, tout spécialement les jeunes personnes trans et non binaires.
Au total, 8396 personnes ont répondu à un questionnaire diffusé sur le Web, principalement via des groupes et associations 2ELGBTQI+ partout au Canada. De ce nombre, 7481 personnes s’identifiaient comme faisant partie de la diversité sexuelle et de genre. Un échantillon de 1024 personnes représentatives de la population générale a été constitué à des fins de comparaison. Fait à souligner : parmi l’ensemble des personnes répondantes, 1309 se sont identifiées comme trans et 1625 comme non binaires. Autre fait saillant : alors que 8,6 % de l’ensemble des personnes répondantes de 18 ans et plus de l’échantillon représentatif de la population générale s’identifient à la diversité sexuelle et de genre, cette proportion est presque deux fois plus élevée chez les 18-34 ans, soit 16,5 %.
- INTRODUCTION
En septembre 2023, la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais[1] mandatait la maison de sondage CROP pour mener une vaste étude sur la situation des personnes de la diversité sexuelle et de genre au Canada. Cette recherche faisait suite à un premier sondage pancanadien similaire, mené en 2017, beaucoup plus modeste en nombre de personnes répondantes (n = 2697 en 2017 ; n = 8396 en 2024), intitulé Réalités LGBT+ au Canada (FJRSD, 2017). L’intention était d’avoir une photographie de la situation actuelle et de voir comment les choses avaient évolué, cela afin de mieux déterminer les priorités et les plans d’action à privilégier en lien avec la lutte contre l’homophobie et la transphobie. L’ambition était en somme que ce sondage aide à mieux saisir les réalités et les enjeux actuels que vivent les personnes issues de la diversité sexuelle et de genre au Canada, mais aussi, à l’aide d’un échantillon représentatif de la population générale, de connaître l’opinion de la société canadienne sur ces questions.
La collecte de données (une cinquantaine de questions posées) s’est déroulée du 5 février 2024 au 11 juin 2024. Elle a permis de recueillir les réponses de 1024 personnes représentatives de la population canadienne âgée de 18 ans et plus, ainsi que les réponses de 7481 personnes âgées de 15 ans et plus considérant elles-mêmes faire partie de la diversité sexuelle et de genre. Ce dernier échantillon n’est pas forcément représentatif, précisons-le, toutes les personnes participantes ayant répondu librement à un sondage mis en ligne sur le Web. Ce sondage a été mené par la firme de sondage CROP, en collaboration avec la FJRSD. On peut consulter en libre accès l’ensemble des questions posées et des réponses détaillées au sondage (194 pages), dont le présent article constitue un bref résumé synthèse[2], via le lien suivant :
https://fondationjasminroy.com/sondage-crop/
L’étude auprès de la population générale a été réalisée auprès d’un panel Web statistiquement représentatif de la population canadienne, composé de 1024 personnes âgées de 18 ans et plus. Les résultats de ce volet ont été pondérés par la méthode des quotas[3], afin de refléter une distribution représentative de la population, notamment selon l’âge, le genre, la scolarité, la région et la langue maternelle des personnes répondantes. Des quotas basés sur les données de Statistique Canada avaient en effet préalablement été établis afin que cet échantillon représente la population canadienne dans sa diversité, dans toutes les régions du pays. Cet échantillon fut consulté en ligne de février à juin 2024.
En ce qui concerne l’échantillon des 7481 personnes de la diversité sexuelle et de genre, il s’agit d’un échantillon essentiellement basé sur le volontariat. La FJRSD et CROP ont sollicité par courriels de nombreuses organisations canadiennes pouvant s’intéresser à l’étude en raison de leur mission ou de leur rôle auprès des populations ciblées. Environ 900 organismes à travers le pays ont été ainsi contactés par courriel pour diffuser le lien menant au sondage (questionnaire dans les deux langues officielles du Canada, au choix des personnes répondantes). Un lien menant au sondage fut également publié sur les réseaux sociaux de la FJRSD. Cette collecte des données auprès de personnes âgées de 15 ans et plus, résidant au Canada et s’identifiant comme faisant partie de la diversité sexuelle et de genre, fut effectuée du 5 février au 11 juin 2024.
Soulignons que la confidentialité des réponses et l’anonymat des personnes répondantes furent, en tout temps, strictement garantis, tel que stipulé dans la présentation du questionnaire. Les questions sensibles (sur les violences subies tout particulièrement) étaient précédées d’un avertissement afin de pouvoir immédiatement passer à une section suivante (ce qui était par ailleurs techniquement possible à toutes les étapes du questionnaire). Une liste d’organismes de soutien aux victimes de violences était aussi proposée.
Afin d’avoir un aperçu de la diversité des personnes 2ELGBTQ+ répondantes, en voici un profil synthèse, débutant par l’identité de genre :
Hommes cisgenres : 1188
Femmes cisgenres : 2685
Hommes trans : 684
Femmes trans : 552
Personnes trans (non spécifiées) : 73
Personnes non binaires : 1625
Personnes en questionnement : 319
Autres identités (par ex. : queer, deux-esprits, agenre, de genre fluide, intersexe, etc.) : 355
Voyons maintenant ce qui concerne l’orientation sexuelle (notons que quelques personnes ont préféré ne pas répondre à cette question, ce qui explique le nombre légèrement moindre de réponses) :
Personnes s’identifiant comme…
homosexuelles, lesbiennes ou gays : 2693
bisexuelles : 1941
asexuelles : 608
pansexuelles : 1253
en questionnement : 288
queers : 457
autres (par ex. : demisexuel.e, omnisexuel.le) : 110
3. CONTEXTE ET REVUE DES ÉTUDES SIMILAIRES MENÉES AU QUÉBEC ET AU CANADA
De nature quantitative, cette recherche est exploratoire (donc sans hypothèses à corroborer). Les questions de recherche ont été développées dans la perspective de mieux connaître différents aspects du vécu des personnes de la diversité sexuelle et de genre au Canada. Deux critères ont présidé à leur élaboration : éclairer des réalités méconnues (par exemple, la possible fluidité dans le genre ou dans l’orientation sexuelle) et peu documentées (par exemple, le pourcentage de personnes ayant subi des thérapies de conversion) ou encore des phénomènes en possible évolution (par exemple, le degré d’acceptation sociale de la visibilité des couples 2ELGBTQ+). Une attention particulière a été consacrée à mieux connaître le vécu de personnes trans et non binaires (par exemple, l’accès, le cas échéant, à des traitements médicaux).
L’analyse et l’interprétation des résultats se sont limitées à ce qui apparaît au premier degré, c’est-à-dire ce que nous disent les données elles-mêmes, en les comparant, lorsque cela était possible, avec celles obtenues par des recherches récentes similaires. Cela dit, lorsque des concepts particuliers (par exemple, le stress des minorités) seront mobilisés pour interpréter certains résultats, ils seront alors brièvement expliqués et référencés. On notera, enfin, qu’un effort particulier a été fait pour que le questionnaire utilise, dans les deux langues officielles au Canada, une écriture épicène (non genrée) simple et accessible.
Bien que longtemps négligée, la nécessité et la légitimité de la recherche sur les réalités LGBTQ+ ne sont aujourd’hui plus à démontrer. Ce fut notamment l’objet d’un numéro de la revue Service social paru il y a quelques années (Service social, 2020). Le but du présent article n’est évidemment pas de faire une revue exhaustive de la documentation disponible sur les problématiques reliées à la diversité sexuelle et de genre (ce qui serait en soi une tâche complètement différente et, disons-le, considérable[4]), mais de présenter une nouvelle recherche empirique menée auprès d’un très vaste échantillon, vraisemblablement un des plus importants en nombre au Canada à ce jour concernant les populations visées. En somme, l’objectif de cette recherche empirique est de produire de la connaissance plutôt que de faire un bilan de celle qui existe déjà sur l’ensemble des sujets abordés (acceptation sociale, services de santé, organismes communautaires, violences subies, etc.). Toutefois, établir des comparaisons avec les principales recherches similaires menées au Québec et au Canada au cours des dernières années était un incontournable. Ne serait-ce qu’afin de souligner les convergences (elles sont nombreuses, comme on le verra). Ce qui explique pourquoi notre recension des écrits se consacrera surtout aux recherches quantitatives québécoises et canadiennes d’ampleur similaire. Ce qui sera riche d’enseignement.
Une première recherche de ce type est la recherche partenariale Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des personnes LGBTQ+ (Enquête SAVIE-LGBTQ+, 2019-2020), qui visait à documenter les expériences de dévalorisation, de dénégation et d’infériorisation privant les personnes LGBTQ+ de leurs droits dans différentes sphères de vie. L’ensemble de ce projet a permis de recueillir les questionnaires de 4980 personnes participantes de 18 ans et plus faisant partie de la diversité sexuelle et de genre et vivant au Québec. Les données ont été amassées de septembre 2019 à août 2020. Elles couvrent un gigantesque éventail, incluant notamment les domaines suivants : emploi, famille, milieu scolaire, relations interpersonnelles, santé et accès aux soins, vie associative. Comme on le verra, cette recherche a exposé plusieurs tendances allant dans le même sens que nos résultats. Par exemple, à l’effet que l’intimidation et la cyberintimidation subies sont sensiblement plus élevées pour les personnes trans et non binaires (Coutu, Blais, Samoilenko et Côté, 2024).
La recherche intitulée Portrait des violences sexuelles subies par les personnes étudiantes 2SLGBTQIA+ en milieu collégial et expériences de signalement à l’établissement – Rapport de recherche du projet Alliance 2SLGBTQIA+ offre aussi un regard sur le vécu des jeunes de la diversité sexuelle et de genre (Bergeron, Goyer, Després, Carignan-Allard, St Hilaire, Blais et autres, 2023). Ce projet, intitulé Alliance 2SLGBTQIA+ : pour une culture de respect, d’égalité et de consentement en milieu collégial, visait une meilleure compréhension des expériences de violences sexuelles subies en milieu collégial par des personnes étudiantes. Pilotée par la Chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles en milieu d’enseignement supérieur de l’Université du Québec à Montréal, elle fut menée en partenariat avec la Chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres, la Fédération des cégeps, le Conseil québécois LGBT et l’organisme Diversité 02. Son volet quantitatif, de loin le plus important (quelques entrevues qualitatives furent aussi réalisées), a rejoint 3203 personnes entre octobre 2021 et mai 2022, lesquelles ont répondu à un questionnaire en ligne. Comme on le verra, les résultats de cette étude croisent les nôtres en ce qui concerne la surreprésentation des jeunes personnes trans et non binaires parmi les victimes de harcèlement et de violences.
À des fins de comparaison concernant spécifiquement le monde du travail, nous nous sommes référés à une publication toute récente de l’Équipe de recherche BRAV (Bien-être et Résilience devant l’Adversité) de l’UQAM en raison de son vaste échantillon de plus de mille personnes de la diversité sexuelle et de genre âgées de 15 à 29 ans (Dion, Baiocco, Blais, Boislard, Philibert et autres, 2024).
Le projet de recherche Santé et bien-être chez les jeunes trans et non binaires, mené en 2019 et publié en 2021, fait aussi état de résultats pouvant recouper les nôtres. Sur une période de 10 semaines en 2019, l’équipe de recherche Trans Pulse Canada (Navarro, Johnstone, Temple Newhook, Smith, Wallace Skelton, Prempeh, Lopez, Scheim, et Bauer, 2021) avait recueilli des données auprès de 2873 personnes trans et non binaires âgées de 14 ans ou plus vivant au Canada. L’accès aux soins et leur qualité de même que les violences subies en milieu familial sont les thèmes centraux de cette étude (Trans Pulse Canada, 2021). Environ 35 %, soit 991, des personnes répondantes étaient des jeunes. Or, ce groupe a indiqué un accès plus restreint aux soins de santé axés sur l’affirmation du genre, un moins bon état de santé mentale et moins d’expériences positives en matière de soins primaires comparativement au reste de l’échantillon. Les taux de violence et de harcèlement rapportés sont aussi très inquiétants. Comme on le verra, ces résultats rejoignent les nôtres.
Enfin, un rapport de recherche du Williams Institute (Flores et Conron, 2023) intitulé Adult LGBT Population in the United States, se propose principalement d’estimer le nombre de personnes de la diversité sexuelle et de genre aux États-Unis, société voisine de la nôtre. Comme on le verra, les pourcentages obtenus concernant l’identification à la diversité sexuelle et de genre chez les jeunes générations ressemblent fort à ceux procurés par notre recherche. Un vaste sondage Gallup mené aux États-Unis en 2024 confirme cette nette tendance : une jeune personne sur cinq aux États-Unis s’identifie désormais comme LGBTQ (GALLUP, 2024). Nous avons donc aussi utilisé, lorsqu’elles étaient disponibles, des données de Statistique Canada, qui s’intéresse de plus en plus aux réalités de la diversité sexuelle et de genre (nous indiquerons alors le site spécifique consulté).
4. RÉSULTATS ET ANALYSE DU SONDAGE
En débutant cette section, précisons l’ampleur de la population concernée. Selon notre enquête, 8,6 % des gens de l’ensemble des personnes répondantes de 18 ans et plus de l’échantillon représentatif de la population générale s’identifient à la diversité sexuelle et de genre. Cette proportion est presque deux fois plus élevée chez les 18-34 ans, soit 16,5 %. Ce dernier pourcentage est même un peu inférieur à celui d’autres enquêtes récentes du même type. En effet, la portion canadienne du sondage LGBTQ+ international de l’IPSOS en 2024, comportant aussi un échantillon de mille personnes, constatait que 22 % des jeunes de moins de trente-cinq ans se disaient LGBTQ+, le double aussi de la population générale (IPSOS, 2024). Les résultats de la plus récente enquête GALLUP aux États-Unis sur le sujet atteint le même pourcentage, 22%, chez la génération Z, née après 2017 (Gallup, 2024).
4.1 Ouverture à la diversité parmi la population canadienne
La proportion de Canadiens et de Canadiennes se disant à l’aise de côtoyer des personnes de la diversité d’identité de genre est de 66 %. Toutefois, une baisse significative de pourcentage survient lorsqu’il est question de rapports d’amitié avec des personnes issues de la diversité. En effet, alors que 91 % des personnes issues de la diversité sexuelle et de genre comptent des personnes homosexuelles, bisexuelles ou pansexuelles parmi leurs relations amicales, c’est seulement la moitié, soit 46 %, au sein de la population générale. Et alors que, parmi les personnes issues de la diversité, 60 % ont des amis trans ou non binaires, c’est seulement 13 % parmi la population générale. Il en résulte une méconnaissance de ces réalités, comme le montreront d’autres réponses du sondage. Il ressort aussi que les hommes cisgenres se disent sensiblement moins à l’aise que les autres sous-groupes avec les personnes trans et non binaires. Ce dernier résultat est similaire à celui obtenu par une recherche québécoise dévoilée en juin 2024 sur les attitudes et perceptions face aux personnes LGBTQ+ (Secrétariat à la condition féminine, 2024).
4.2 Acceptabilité sociale des manifestations affectives en public
La population canadienne semble aussi plus réservée que les personnes issues de la diversité sexuelle et de genre en ce qui concerne les manifestations affectives en public, d’où qu’elles proviennent. Ainsi l’échantillon représentatif de la population canadienne se dit sensiblement moins à l’aise devant deux personnes se tenant la main en public, tout spécialement lorsqu’il ne s’agit pas d’un homme et d’une femme. À peine une personne sur deux de la population générale se dit très à l’aise de voir deux femmes se tenir la main (57 %), deux hommes se tenir la main (50 %) ou une personne trans ou non binaire tenir la main d’une autre personne (49 %). Or, chez les gens de la diversité, environ 9 personnes sur 10 sont très à l’aise avec ces mêmes comportements (respectivement 91 %, 89 % et 87 %).
Parmi l’échantillon de la population générale, seulement 36 % des gens se disent à l’aise de voir deux femmes s’embrasser sur la bouche en public, 31 % de voir deux hommes s’embrasser sur la bouche en public et 32 % de voir une personne trans ou non binaire embrasser une autre personne sur la bouche en public. Les jeunes entre 15 et 24 ans et les 55 ans et plus sont les groupes les moins à l’aise de voir ces démonstrations d’affection en public. C’est envers les personnes trans, non binaires ou non conformistes sur le plan du genre que ce malaise atteint un sommet. En effet, seulement le tiers en moyenne des gens de la population générale sont très à l’aise de voir deux personnes de même sexe ou encore une personne trans ou non binaire et une autre s’embrasser en public sur la bouche. Et moins du quart de l’échantillon de la population générale se dit très à l’aise que des enfants voient des personnes de même sexe, trans ou non binaires s’embrasser en public.
4.3 Acceptation et intégration sociale de la diversité
En ce qui concerne l’acceptation et l’intégration de la diversité au sein de la société canadienne, 51 % des gens de l’échantillon représentatif de la population canadienne sont d’avis que la situation s’est améliorée ces dernières années. Or, la perception n’est pas du tout la même parmi les personnes de la diversité sexuelle et de genre : 39 % d’entre elles ont l’impression que les choses se sont détériorées au cours des 3 dernières années, comparativement à 14 % pour la population générale.
Par ailleurs, seulement 41 % des personnes représentatives de la population générale se disent à l’aise de voir une femme s’habiller et se comporter de manière masculine en public ; 37 % se disent à l’aise de voir un homme s’habiller et se comporter de manière féminine en public. Sur ce plan, la population générale est en moyenne jusqu’à deux fois moins à l’aise avec l’expression de la diversité de genre que les membres de cette dernière.
4.4 Gradation et fluidité de l’identité de genre
Pour mesurer la possible gradation de la fluidité de l’identité de genre, nous avons demandé aux personnes participant au sondage de nous indiquer où elles se situaient sur une échelle en onze points allant de zéro à dix, 0 signifiant qu’elles se sentaient totalement masculines et 10 totalement féminines. La moyenne obtenue pour les hommes canadiens cisgenres de la population générale est de 1,8 sur 10. Chez les femmes cisgenres de la population générale, c’est de 8,4 sur 10. Ces moyennes sont nettement moins polarisées parmi les personnes de la diversité sexuelle et de genre puisqu’elles se situent à 2,9 sur 10 pour les hommes cisgenres de la diversité et à 6,8 pour les femmes cisgenres de la diversité.
4.5 Gradation et fluidité de l’orientation sexuelle
Les fantasmes sont, avec les comportements et le sentiment d’appartenance, un des indicateurs fiables de l’orientation sexuelle d’une personne. Une nette majorité des hommes hétérosexuels cisgenres, soit 85 %, de notre échantillon, indiquent mettre en scène uniquement des femmes dans leurs fantasmes. Cela dit, 10 % des hommes hétérosexuels cisgenres déclarent avoir des fantasmes homosexuels et 5 % avoir aussi des fantasmes avec des personnes trans ou non binaires (ce n’est qu’un pour cent chez les femmes cisgenres). Chez les femmes hétérosexuelles cisgenres, 65 % mettent en scène uniquement des hommes dans leurs fantasmes. L’attrait pour des personnes du même sexe est donc sensiblement plus présent chez les femmes hétérosexuelles cisgenres puisque 25 % d’entre elles expriment avoir des fantasmes lesbiens.
Sur le plan des conduites sexuelles, 9 % des femmes qui s’identifient comme hétérosexuelles ont déjà eu des rapports avec des personnes de leur sexe; c’est 7 % chez les hommes se décrivant comme hétérosexuels. Un pour cent des personnes hétérosexuelles ont déjà eu des rapports sexuels avec une personne trans ou non binaire. Parmi les hommes et les femmes cisgenres de la diversité, le pourcentage de personnes ayant eu des rapports sexuels avec une personne trans ou non binaire passe à 17 %. Environ la moitié des personnes trans ou non binaires ont eu des relations sexuelles avec d’autres personnes trans ou non binaires.
4.6 Questionnement, acceptation et affirmation de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre
Les personnes de la diversité sexuelle et de genre rapportent une plus grande fluctuation de leur orientation sexuelle dans le temps (à 57 %) que la population générale (à 16 %). Spécifions que la fluctuation fut plus grande parmi les personnes bisexuelles, pansexuelles, queers et en questionnement. Elle est particulièrement élevée chez les plus jeunes : c’est 71 % chez les 15-17 ans.
Les hommes gays sont ceux chez qui l’orientation sexuelle aurait le moins fluctué dans le temps (cela se serait produit chez 28 % d’entre eux). Cela dit, les questionnements relatifs à l’orientation sexuelle débutent habituellement à l’enfance (entre 6 et 12 ans chez 29 % des gens de la diversité) ou à l’adolescence (entre 13 et 19 ans chez 43 % des personnes de la diversité). Plus rarement, cela se passe au début de la vie adulte (c’est à 12 % entre 20-34 ans). L’acceptation et l’affirmation de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre s’ensuivent logiquement et se manifestent principalement à l’adolescence ou tout juste après, au début de la vie adulte, pour la vaste majorité des gens. Cela se produit à 35 ans et plus dans moins de 10 % des cas.
Les questionnements relatifs à l’identité de genre débutent plus tôt que ceux sur l’orientation sexuelle. En effet, le questionnement sur l’identité de genre, le cas échéant, débute souvent avant 13 ans (dans 41 % des cas), voire avant l’âge de 6 ans dans un nombre significatif de cas (16 %). L’acceptation et l’affirmation de soi suivent quelques années plus tard et se produisent généralement à l’adolescence ou tout juste après. L’accueil des proches est souligné comme étant alors précieux (ce qui ressort aussi de l’enquête SAVIE-LGBTQ, 2019-2020). Fait à souligner, plus de la moitié des hommes trans ont débuté leur questionnement avant l’âge de 13 ans. C’est aussi ce groupe qui déclare vivre le plus précocement l’acceptation et l’affirmation de son identité de genre, à l’adolescence.
Au moment du sondage, la vaste majorité des personnes de la diversité sexuelle et de genre se disaient confortables avec leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Cela dit, plus on est âgé, plus on est l’aise à parler ouvertement de son orientation sexuelle. En effet, les jeunes entre 15 et 34 ans se disent sensiblement moins à l’aise que les autres de parler ouvertement de leur orientation sexuelle.
4.7 Les thérapies dites de conversion
En moyenne 4% du total des personnes de la diversité sexuelle et de genre rapportent avoir été soumises à des thérapies dites de conversion. Toutefois, ce pourcentage augmente à 7 % chez les hommes trans et les personnes non binaires, à 9 % chez les femmes trans et les personnes trans bisexuelles et même à 10 % chez les personnes non binaires homosexuelles. Ces groupes sont donc, ou du moins ont été, les plus vulnérables sur ce plan. Notons que, selon les données du projet SAVIE-LGBTQ, 5 % des jeunes LGBTQ ont été victimes de thérapies de conversion (SAVIE-LGBTQ, 2022), une proportion assez similaire à celle que nous avons trouvée.
4.8 Les ressources communautaires
Le quart des personnes de la diversité ont déjà fait appel à des organismes communautaires ou à des groupes d’entraide en lien avec leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Cependant, chez les personnes trans, c’est le double : pour les hommes trans, 50 % ; chez les femmes trans, 55 %.
Dans l’ensemble, les trois quarts (76 %) des personnes ayant eu recours à des organismes communautaires estiment que le soutien obtenu était très ou assez satisfaisant. Parmi les différentes ressources disponibles, les réseaux sociaux (52 %) et le Web en général (42 %) ressortent comme les plus aidants dans le processus d’apprivoisement, d’acceptation ou d’affirmation de son identité de genre et/ou de son orientation sexuelle. On note cependant que les personnes de la diversité sont deux fois plus nombreuses (58 %) que la population générale (30 %) à estimer que les ressources communautaires LGBTQ+ sont insuffisantes. Plus des trois quarts des personnes trans et non binaires répondantes estiment que les ressources disponibles pour elles sont insuffisantes. Les personnes de 35 ans et plus de la diversité sont aussi plus critiques concernant le manque de ressources : près de deux personnes sur trois parmi elles (62 %) les considèrent insuffisantes.
4.9 Les traitements médicaux chez les personnes trans et non binaires
Des traitements hormonaux et des chirurgies sont rapportés respectivement dans 76 % et 37 % des cas chez les personnes trans, et à 20 % et 13 % parmi les personnes non binaires. À noter que parmi les personnes ayant opté pour ces traitements, 53 % rapportent que l’accès à ces services fut difficile. C’est compatible avec les résultats de l’enquête SAVIE-LGBTQ (2019-2020), dans laquelle presque la moitié des personnes trans et non binaires, en particulier les plus jeunes, estiment avoir des besoins non comblés sur le plan des services de santé.
Un homme trans sur deux (48 %) a eu recours à la chirurgie afin de mieux vivre son identité de genre. Chez les femmes trans, 29 % ont opté pour une chirurgie. Elles sont cependant plus nombreuses à avoir recours à une prise d’hormones (à 81 % versus 72 % chez les hommes trans). Dans la tranche d’âge des 25-34 ans, celle où ces chiffres sont les plus élevés, 90 % des personnes trans rapportent une prise d’hormones et 45 % une chirurgie. Un peu plus d’une jeune personne trans de 15 à 17 ans sur quatre (28 %) a débuté la prise d’hormones. Rares sont les chirurgies rapportées dans ce groupe d’âge : 4 %.
4.10 Les violences subies
Les personnes issues de la diversité sexuelle et de genre subissent davantage de violences et de discriminations. Elles sont nettement plus ciblées que la population générale : alors que 27 % de cette dernière déclare ne jamais avoir été victimes de violence ou de discrimination, c’est seulement 8 % chez les personnes de la diversité. Au cours des 12 derniers mois précédant le sondage, 23 % de la population générale au pays dit avoir vécu de la violence, alors que pour les personnes de la diversité sexuelle et de genre, ce pourcentage s’élève à 46 %, soit le double. Cette tendance confirme les données disponibles de Statistique Canada : À l’exclusion de la violence commise par un partenaire intime, 59 % des personnes LGB+ au Canada avaient été agressées physiquement ou sexuellement au moins une fois depuis l’âge de 15 ans, ce qui représente une proportion beaucoup plus importante que celle des personnes hétérosexuelles ayant déclaré la même chose (37 %) (Statistique Canada, 2024b). Pire encore, selon la même source, 6 % des personnes LGB+ âgées de 15 ans et plus au Canada ont déclaré avoir été agressées physiquement au moins une fois au cours des 12 mois précédant l’Enquête sur la sécurité dans les espaces publics et privés (ESEPP) de 2018 (Statistique Canada, 2024b).
Selon notre enquête, au cours de leur vie, 54 % des personnes de la diversité ont été victimes de discrimination ou de violence verbale, psychologique, physique ou sexuelle en lien avec leur apparence, 39 % en lien avec leur identité de genre, leur genre ou leur sexe, 51 % en lien avec leur orientation sexuelle et 19 % en lien avec une situation de handicap. Ces pourcentages sont en harmonie avec ceux obtenus par la recherche Alliance 2SLGBTQIA+, dans laquelle un peu plus de la moitié des personnes interrogées ont indiqué avoir subi au moins une situation de harcèlement sexuel, de comportements sexuels non désirés ou de coercition sexuelle par une personne affiliée au même établissement qu’elles (Bergeron, Goyer, Després, Carignan-Allard, St Hilaire, Blais et autres, 2023). Statistique Canada conclut de ses données que trois quarts des jeunes de la diversité sexuelle et de genre ont vécu du harcèlement dans la dernière année avant qu’ils soient interrogés à ce sujet (Statistique Canada, 2022b).
Selon notre recherche, les violences subies sont les plus élevées chez les personnes trans et non binaires et chez les jeunes de la diversité entre 15 et 17 ans (au moins le double de la moyenne). Ces résultats vont dans le même sens que ceux obtenus par la recherche de 2019 menée par Trans Pulse, laquelle indique qu’au cours des cinq dernières années, 72 % des jeunes trans ou non binaires ont subi du harcèlement verbal et qu’une jeune personne trans ou non binaire sur 5 a évité l’école au cours des 5 dernières années par peur de se faire harceler ou de voir son identité de genre divulguée (Navarro, Johnstone, Temple Newhook, Smith, Wallace Skelton, Prempeh, Lopez, Scheim et Bauer , 2021).
Une personne sur deux (52 %) soutient que les sites de réseaux sociaux (Facebook, Instagram, TikTok, etc.) sont bénéfiques dans l’apprivoisement, l’acceptation ou l’affirmation de leur identité de genre et de leur orientation sexuelle. Malgré ces avantages, Internet est également perçu comme un endroit où les personnes de la diversité sexuelle et de genre subissent de l’intimidation et de la violence. Les personnes de la diversité se disent en effet trois fois plus victimes de cyberviolence que le reste de la population (32 % versus 10 %). Si on se concentre sur les 12 derniers mois avant le sondage, 17 % des hommes trans, 31 % des femmes trans et 20 % des personnes non binaires ont vécu de la cyberviolence. À souligner : les plus jeunes personnes interrogées de la diversité (15-17 ans) sont, parmi tous les groupes d’âge, les plus à risque d’avoir subi de la cyberviolence (une personne sur quatre) et l’une ou l’autre des formes de violence ou discrimination abordées dans le sondage.
Le lieu de travail et les établissements scolaires sont les lieux les plus susceptibles de produire des violences et des discriminations. Dans 18 % des cas, l’agression subie par les personnes de la diversité sexuelle et de genre était le fait de collègues de travail ou d’études. Cela confirme des résultats similaires obtenus par une recherche spécifique sur le harcèlement au travail publiée en mars 2024 (Dion, Baiocco, Blais, Boislard, Philibert et Équipe de recherche BRAV, 2024). Fait notable, près d’un jeune âgé de 15 à 17 ans sur deux (46 %) ayant subi de la violence au cours des 12 derniers mois affirme que l’épisode s’est déroulé au sein ou à proximité d’un établissement scolaire.
La bonification des cours d’éducation à la sexualité est d’ailleurs identifiée, tant par les personnes de la diversité que par l’échantillon général, comme l’action la plus utile pour favoriser le bien-être et l’intégration des personnes de la diversité sexuelle et de genre. Cela fait sens puisque la vaste majorité des jeunes commencent à se questionner sur leur orientation sexuelle ou leur identité de genre durant la période de fréquentation scolaire (entre 6 ans et 19 ans).
Lors de leur dernier épisode de discrimination ou de violence qu’elles ont vécu, 18 % des personnes de la diversité sexuelle et de genre se trouvaient dans une résidence privée, 12 % au travail, 16 % en ligne (sur Internet), 14 % dans des lieux publics et 12 % dans un établissement scolaire ou à proximité. Dans 48 % des cas, les personnes connaissaient leurs agresseurs. 73 % des personnes de la diversité rapportent que les agressions subies ont été commises par des hommes, 33 % par des femmes et 5 % par des personnes trans ou non binaires. Par ailleurs, 17 % des agresseurs avaient moins de 18 ans, 28 % étaient âgés entre 18-29 ans, 44 % entre 30-50 ans, 21 % avaient plus de 50 ans. Fait notable : chez les 15-17 ans, 66 % des agresseurs avaient moins de 18 ans, donc plus ou moins du même âge. À noter aussi que les femmes bisexuelles sont les plus susceptibles de vivre de la violence de la part de leur(s) partenaire(s).
4.11 Questions de santé
De nombreuses personnes de la diversité sexuelle et de genre évaluent négativement l’état de leur santé mentale. Davantage de personnes de la diversité rapportent en effet un état de santé mentale « passable » ou « mauvais » (à 60 % comparativement à 32 % pour la population générale). Le quart des personnes de la diversité estime que leur santé mentale est « mauvaise » ; c’est seulement 8 % parmi la population. Les personnes en questionnement (77 %), non binaires (74 %) ou trans (66 %) sont celles qui rapportent le plus un mauvais état de santé mentale. Et c’est encore une fois chez les jeunes de 15 à 17 ans que c’est le plus élevé.
Selon Statistique Canada, 3 fois plus de personnes de la diversité sexuelle et de genre rapportent éprouver des problèmes de santé mentale, ce qui est trois fois plus que la population non 2ELGBTQI+ (Statistique Canada, 2024a). Selon l’organisme, plus de 6 personnes transgenres ou non binaires sur 10 (65 %) au Canada ont déclaré que leur santé mentale était passable ou mauvaise, comparativement à environ 1 personne cisgenre sur 10 (11 %). De même, les personnes transgenres et non binaires au Canada étaient plus susceptibles que les personnes cisgenres de déclarer avoir reçu un diagnostic de trouble de l’humeur ou d’anxiété (61 % par rapport à 17 %) ou avoir sérieusement envisagé de se suicider au cours de leur vie (45 % par rapport à 16 %) (Statistique Canada, 2024b).
Dans notre propre enquête, les personnes de la diversité sont deux fois plus nombreuses à avoir reçu un diagnostic de dépression (49 % contre 26 % parmi la population générale) ou de trouble anxieux (48 % contre 26 %). Ces diagnostics atteignent un pic chez les personnes non binaires (dépression: 66 %; trouble anxieux: 66%) et des hommes trans (dépression: 66 %; trouble anxieux : 64 %). Ces résultats concordent assez avec ceux obtenus par l’enquête SAVIE-LGBT+ (2019-2020), selon laquelle plus du tiers des personnes LGBQ et plus de la moitié des personnes trans et non binaires avaient une condition diagnostiquée en santé mentale.
Au cours des 12 derniers mois ayant précédé notre sondage, 40 % des personnes de la diversité interrogées rapportent avoir eu des idées suicidaires. C’est plus de trois fois plus que parmi la population générale (12 %). Et ces chiffres sont encore plus élevés chez les personnes trans et non binaires, soit entre 55 % et 65 %. Cela rejoint les pourcentages obtenus par l’enquête de Trans Pulse, qui constate que chez les jeunes personnes transgenres et non binaires, 2 sur 5 ont songé au suicide au cours de l’année écoulée ; 1 sur 10 a fait une tentative de suicide (Navarro, Johnstone, Temple Newhook, Smith, Wallace Skelton, Prempeh, Lopez, Scheim, et Bauer , 2021). Dans notre propre enquête, près de 75 % chez les jeunes trans de moins de 24 ans ont eu des idées suicidaires au cours des 12 derniers mois; c’est à peine moins chez les jeunes non binaires du même âge (70 % chez les 15-17 ans et 65 % chez les 18-24 ans).
Fait très alarmant, une jeune personne trans ou non binaire sur cinq âgée de 15 à 17 ans rapporte avoir fait au moins une tentative de suicide au cours des 12 derniers mois; c’est une sur dix chez les 18-24 ans du même groupe. Au total, alors que 2 % de la population générale a déjà effectué une tentative de suicide, c’est plutôt 5 % parmi les personnes issues de la diversité. Et c’est beaucoup plus encore parmi certains sous-groupes : cette proportion atteint en effet des sommets chez les jeunes de 15 à 17 ans trans (20 %) et non binaires (23 %)
Les problèmes de dépendance (21 %), de troubles alimentaires (20 %) et de troubles cognitifs (18 %) sont également deux à quatre fois plus élevés chez les personnes de la diversité que dans la population générale. Enfin, c’est à souligner, les personnes de la diversité sont deux fois et demie moins à l’aise de poser toutes les questions qu’elles souhaiteraient lors de visites médicales (17 % versus 7 % pour la population générale).
5. DISCUSSION DES RÉSULTATS ET RECOMMANDATIONS
Il ressort de ce sondage que la perception qu’ont les personnes de la diversité sexuelle et de genre de leurs réalités diffère sensiblement de celle de la population générale, cela sur plusieurs plans. En effet, la population générale semble moins ouverte à l’expression publique de la diversité (par exemple, des couples s’embrassant), quoique s’estimant plus satisfaite des ressources destinées aux minorités sexuelles ou de genre et de l’évolution des mentalités. La population générale semble aussi peu en contact avec des réalités telles que la transidentité et la non-binarité, ce qui peut être source de méconnaissance, voire de préjugés.
Ce sondage a permis de rejoindre un très grand nombre de personnes trans et non binaires (au total, ce groupe constitue 2934 des personnes répondantes). Sur ce plan, il serait, avec l’enquête menée en 2019 et rapportée en 2020 de l’organisme Trans Pulse, lequel comportait un échantillon de 2873 personnes, l’un des plus vastes à ce jour concernant cette population au Canada. Or, leurs conclusions respectives vont sensiblement dans le même sens (Trans Pulse, 2021) : il y a urgence de mieux soutenir ces populations. En effet, il ressort nettement de notre étude que les personnes trans et non binaires, en particulier les plus jeunes, rencontrent et éprouvent davantage de problèmes que tous les autres groupes, cela sur presque tous les plans abordés par le sondage. Leur situation mériterait assurément beaucoup plus d’attention des services publics (santé physique ou mentale et milieux scolaires, en particulier) et de ressources appropriées. D’autant que leur nombre de personnes se reconnaissant comme trans ou non binaires va croissant chez les plus jeunes générations.
Selon Statistique Canada, plus de cent mille personnes de quinze ans et plus se déclaraient trans ou non binaires en 2021. C’est presque 1 % de la population de 20 à 25 ans (Statistique Canada, 2022a). Notons que, puisque c’est souvent un parent qui répond au recensement pour son ménage ou sa famille (Statistique Canada, 2022c), il est probable que ce chiffre soit sous-estimé. Comme le Canada fut le premier État à poser dans un recensement national ce type de question, il est difficile pour le moment de comparer ces chiffres officiels avec ceux d’autres pays. Toutefois, d’après deux mégabases de données sur les jeunes Américains, il y aurait 1,4 % de personnes trans ou non binaires parmi les adolescents de 13 à 17 ans (Williams Institute, 2020). Le pourcentage est assez similaire dans le reste du monde : à la suite d’un sondage mené dans 30 pays auprès de 22 500 personnes répondantes, la maison IPSOS estime à au moins 2 % la proportion de la population trans ou non binaire (IPSOS, 2023) parmi la génération Z née après 1997, donc âgée de 16 à 25 ans au moment d’un sondage mené en 2023. En ajoutant à leur questionnaire les catégories genre non-conformiste ou fluide dans leur sondage de 2024, l’équipe de recherche IPSOS obtient 3 % des jeunes se déclarant non cisgenres chez la jeune génération Z (IPSOS, 2024). La maison de sondage GALLUP obtient une proportion similaire : 2,1 % de personnes se déclarent trans chez la génération Z (GALLUP, 2024). Ces nombres ne sont pas négligeables.
Il importe en somme que les services publics, en particulier les milieux scolaires ou de travail et le système de santé, adaptent leurs pratiques à ces réalités. Pour ce faire, nous avons identifié quelques actions qui, au vu des résultats de notre sondage, seraient importantes, voire urgentes.
5.1 Lutter contre les violences et les discriminations
Les personnes issues de la diversité sexuelle et de genre, tout particulièrement les plus jeunes, sont bien davantage l’objet de violence et de discrimination que les autres, a montré notre enquête (et elle est en cela compatible avec ce que des recherches du même type avaient précédemment découvert). Alors qu’au cours des 12 derniers mois, 23 % de la population générale au pays a vécu de la violence, ce pourcentage s’élève à 46 % pour les personnes de la diversité sexuelle et de genre. À vie, 69 % de la population canadienne a connu une forme de violence ou de discrimination, comparativement à 89 % pour les personnes de la diversité. Ces chiffres montrent que, malgré une légère évolution dans l’acceptation des personnes issues de la diversité constatée au regard du sondage FJRSD-CROP mené en 2017 (FJRSD, 2017), ces dernières sont encore beaucoup des cibles de violence.
5.2 Contrer les violences et discriminations en milieux de travail et scolaires
Le lieu de travail et les établissements scolaires sont des lieux à surveiller de près concernant les violences et les discriminations. Ils sont en effet impliqués dans 24 % des cas du dernier épisode de discrimination ou de violence. Dans 18 % des cas, les agressions subies par les personnes de la diversité sexuelle et de genre étaient le fait de collègues de travail ou d’études. Près d’un jeune âgé entre 15 et 17 ans sur deux (46 %) ayant subi de la violence ou de la discrimination au cours des 12 derniers mois affirme que cela s’est déroulé au sein ou à proximité d’un établissement scolaire. C’est extrêmement préoccupant. Des programmes spécifiques et des mesures éducatives pro-diversité, axés sur des apprentissages civiques, sociaux et émotionnels chez tous les jeunes, devraient à l’évidence être davantage encouragés, voire être obligatoires au programme scolaire.
5.3 Prévenir et contrer la violence sur le Web
Le Web constitue manifestement une ressource utile pour les personnes de la diversité sexuelle et de genre, qui y voient un environnement positif permettant d’être en contact avec des pairs et avec des informations précieuses. Selon notre sondage, environ une personne sur deux soutient que les réseaux sociaux et Internet ont été ou sont encore bénéfiques dans l’apprivoisement, l’acceptation ou l’affirmation de leur identité de genre et/ou leur orientation sexuelle. Malgré ces avantages, le Web est également un endroit où les personnes de la diversité sexuelle et de genre subissent de l’intimidation et de la violence. Selon notre étude, elles sont en effet trois fois plus victimes de cyberviolence que le reste de la population (32 % contre 10 %). Si on se concentre sur les 12 derniers mois, ce sont les personnes trans (26 %) et les plus jeunes de la diversité (25 % chez les 15-17 ans) qui en ont été victimes. C’est pourquoi des programmes spécifiques de sensibilisation et de prévention devraient être développés sur ce plan (idéalement en collaboration avec les réseaux et les sites en question, qui devraient être davantage sensibilisés et responsabilisés).
5.4 Faciliter l’accès à du soutien en santé mentale
Le sondage dévoile que beaucoup de personnes de la diversité rapportent un état de santé mentale « passable » ou « mauvais » : c’est 60 % versus 32 % pour la population générale canadienne. Le niveau de stress est aussi plus élevé parmi les personnes de la diversité (6,5/10) que parmi la population générale (5,3/10). Cela tendrait à confirmer l’existence de ce que l’on appelle le stress des minorités ou minority stress[5] en langue anglaise (Frost et Mayer, 2021) chez les personnes de la diversité sexuelle et de genre.
Les personnes de la diversité interrogées sont deux fois plus nombreuses à avoir reçu un diagnostic de dépression (49 % contre 26 % parmi la population) ou de trouble anxieux (48 % versus 26 % chez la population générale). Le constat est le même pour les problèmes de dépendance (21 % parmi les personnes de la diversité contre 12 % dans la population) et les troubles alimentaires (20 % parmi les personnes de la diversité contre 8 % dans la population générale). La différence est significative.
Quatre personnes de la diversité sur dix (40 %) nous révèlent avoir eu des idées suicidaires au cours des 12 derniers mois, ce qui est trois fois plus que parmi la population générale (12 %). Ces chiffres sont très inquiétants, d’autant qu’ils atteignent des sommets chez les jeunes trans et non binaires, les plus en détresse de tout notre échantillon. Cette population a des besoins qui sont insuffisamment pris en compte sur le plan de l’intervention et de la prévention. Il serait primordial d’instaurer des mesures accessibles d’aide en santé mentale pour les personnes de la diversité, en particulier les jeunes. D’ailleurs, plus de la moitié (58 %) des personnes de la diversité évaluent les ressources d’aide ou de soutien qui leur sont disponibles comme étant insuffisantes.
5.5 Bonifier les cours d’éducation à la sexualité à l’école
La bonification des cours d’éducation à la sexualité est identifiée, tant par les personnes de la diversité que par la population générale, comme l’action la plus susceptible de favoriser le bien-être et l’intégration des personnes de la diversité sexuelle et de genre. Puisque la vaste majorité des jeunes commencent à se questionner sur leur orientation sexuelle et leur identité de genre durant la période de fréquentation scolaire (soit entre 6 et 19 ans), l’éducation à la sexualité devrait s’assurer de toujours couvrir constructivement les réalités et vécus LGBTQ+ chez les jeunes.
5.6 Financer la recherche sur de vastes échantillons concernant la diversité sexuelle et de genre
Enfin, la recherche sur le vécu et les besoins des populations de la diversité sexuelle et de genre, en particulier des plus jeunes générations, devrait être davantage encouragée et financée par les institutions publiques. Malgré une certaine évolution au cours des dernières années, il existe encore peu de données basées sur de vastes échantillons sur leurs conditions de vie, en particulier au Québec. Un manque serait à combler sur ce plan (notons que la présente recherche fut à 100 % financée par une fondation vu le manque de fonds publics). Assurément, une meilleure connaissance des problèmes des populations 2ELGBTQI+ permettrait d’acheminer les ressources et de prioriser les actions là où les besoins sont documentés (comme le montre ce sondage, ils sont nombreux).
6. CONCLUSION
Mener ce sondage et surtout en analyser les résultats a été l’occasion d’apprendre beaucoup du vécu des personnes de la diversité sexuelle et de genre au Canada aujourd’hui. Manifestement, de telles enquêtes devraient être récurrentes, car elles permettent de prendre le pouls de populations encore méconnues, en particulier les minorités parmi les minorités (dont les plus jeunes, les personnes trans et non binaires). Avoir eu la possibilité de rejoindre un aussi grand nombre de personnes répondantes acceptant de partager leurs réalités et leurs opinions avec nous fut un privilège, que nous avons tenu à partager à travers le présent article. Nous sommes néanmoins conscients qu’il reste assurément beaucoup encore à comprendre et à faire comprendre en ce qui concerne la diversité sexuelle et de genre. Puissent les résultats de cette recherche constituer un jalon en ce sens.
[1] Dans la suite de cet article, la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais sera ainsi identifiée : la FJRSD.
[2] À noter que les données du sondage recueillies sur la conjugalité et la composition familiale devaient être analysées dans un second temps, ce qui restait à faire au moment où ces lignes sont écrites.
[3] La méthode des quotas consiste à établir des variables dont on connaît par avance la représentation dans la population générale afin de construire en quelque sorte un modèle réduit, et représentatif, de la population étudiée.
[4] Certains sites sont consacrés à relever ce défi, dont aux États-Unis, en langue anglaise, dont celui de Statista et de la Santé publique américaine, cités en bibliographie du présent article (Statista; Office of Disease Prevention and Health Promotion).
[5] Terme hélas souvent improprement traduit par stress minoritaire; or, ce sont les gens qui vivent ce stress qui sont en situation minoritaire, et non pas le stress lui-même.